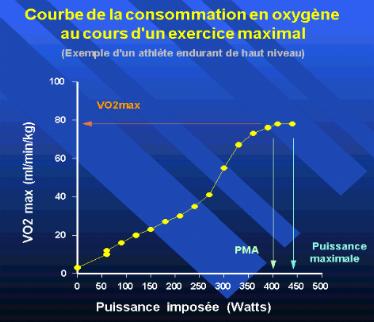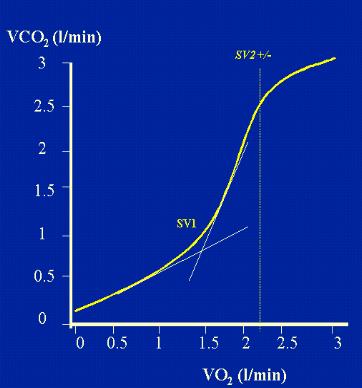textes
Jean Thevenet

L'entraînement: notions apprises ou évoquées pour
la formation du 24 janvier 2004 au pôle de Miribel.
Noir ce qui a été dit (à prendre sous réserve
que c'est forcément interprété par moi même
puisque chacun note en fonction de son psychisme, à moins de faire
de la sténo ou de retranscrire un enregistrement mot à mot:
ne mettez pas ces propos sous la responsabilité des formateurs...)
en autres couleurs ce que j'ai ajouté par la suite, servant
de base à l'approfondissement
bleu, ce que j'ai déduit ou ajouté
moi même. (considérez ça comme des point de vue strictement
personnels et ne mettez ça en aucun cas sur le responsabilité
des formateurs)
bleu clair: quand je parle "de moi, oui: MOÂ"
à titre de comparaison.
sur mon journal il y a une recherche autodidacte,
à tâtons à confronter avec ce qui est officiellement
connu.
Importance du caractère anaérobie en
aviron.
Un rameur en aviron a une étonnante capacité à
utiliser le procédé anaérobie et à dépasser
des seuils physiologiquement intolérables dans d'autres disciplines:
il existe une concentration de lactate qui rend l'effort intolérable
au point de stopper: ce seuil est habituellement 4... Le sportif du haut
niveau atteint 9 environ dans la plupart des disciplines.
Les recordmans d'effort en aviron dépassent allègrement
les concentrations habituelles de lactates
le record d'ergomètre chez les PL (<72.5Kg) est tenu par
un suédois: il avait 32 de lactates à la fin: valeur à
comparer avec des marathoniens en fin de course qui n'ont que 9 et la valeur
de 4 qui est déjà handicapante chez le sportif ordinaire.
ergo 6'03 moyen minimal 450 watts 6.5w/kg). (450
watts ne semble pas extraordinaire, mais attention: sur machine à
ramer.)
(record français des PL 6'10 = 438 watts 6.25w/kg)
J.C Roland 5'41 546 watts (pèse 90 Kg) 6.0w/kg fini ses test
à 9 de lactates. Alors que penser des 32 du suédois?... c'est
révélateur.
Il a été démontré que 80% de l'énergie
nécessaire à un 2000m provient du métabolisme aérobie
(20-22% anaérobie) Cette valeur moderne a été établie
après le constat que la dette en oxygène (remboursement quand
on souffle et que le coeur bat encore alors que l'effort est réduit)
était supérieure au déficit (l'effort produit alors
que la FC ou consommation d'oxygène n'est pas stabilisé)
la connaissance pointue du domaine anaérobie est lacunaire.
le moniteur du stage Hugo MACIEJEWSKI, passionné de physiologie,
ramant depuis 12 ans, champion de france à l'occasion prépare
sa thèse en ce domaine.
(on remarque que le rapport puissance sur poids
des plus lourd n'atteint pas celui des légers.
Je remarque aussi que les puissances mesurées
à l'ergo rameur sont inférieures à celle que l'on
parle généralement dans les test d'effort en général
trouvés sur ergo cycle: voir la rubrique sur test d'efforts)
http://ukatak.free.fr/actu2.php
05/01/2004 Résultats
des tests ergo Le mois de décembre est généralement
celui des tests ergométriques pour tous.
Voici donc les résultats des principaux
prétendants à une coulisse dans le double pl:
Fred Dufour: 6'14,7"
Thibaud Chapelle: 6'15,0"
Pascal Touron: 6'16,5"
Xavier Dorfman: 6'16,5"
si 71 Kg 436 watts minimum 15.9 km/h avec skiff jullien 17.00 avec vrai
skiff: capable de faire 7'03 au 2000
Pierre Pollez: 6'17,4"
Fabrice Moreau: 6'22"
intéressant
aussi Xavier pédale... (master beaujolais course cycliste)
Dossard Nom
Âge Dep Cat Temps officiel Gén.Cat Ecart/1er
Km/h Temps réel brevet
60
DORFMAN XAVIER 30 73 D
05:00:28:000 16 9 00:12:11 32.15 05:00:13:993
487
MARTIN JEAN CHARLES 30 54 D
04:48:17:000 1 1 00:00:00 33.51
04:47:53:000
Il s'est fait larguer quand même de 12'
MARTIN JEAN CHARLES n'a pas l'air pourtant d'être une célébrité
particulière... dur, le vélo...
Effets de la durée sur l'utilisation du
lactate:
Pendant très longtemps, le lactate a été
considéré à tort comme une des causes principales
de la fatigue physique et que son élimination était fonction
de la dette d'oxygène. L'utilisation récente de molécules
marquées et l'apparition de nouvelles théories démontrent
clairement que ce métabolite joue un rôle prépondérant
dans les mécanismes énergétiques de l'organisme. (texte
en marron: extrait de http://physiomax.com.free.fr/
)
Ainsi si on a une concentration importante de
lactates on n'est pas fatigué. il ya un état d'inconfort
du à l'acide provoquée par les réactions anaérobie,
non aux lactates. si on repart en endurance douce on récupère
l'énergie des lactates.
Puissance de course: 80% d'aérobie
plus 20% d'anaérobie?
examinons mon cas
si on j'ai puissance aérobie maximale
de 350 watts sur machine à ramer (donc 80% de 425 watts) en
tout moyen sur un 2000 il devrait m'être possible de descendre à
6'20 à l'ergo
pour cela il faut, 423w, par rapport à
350 +21%.
Je fait 6'39 à l'ergo (il avait
été
mesuré 365 watts moyens soit 4% anaérobie)
J'ai fait ce test quasiment "en palier": je me
suis simplement mis à 1'40 du début à la fin...
je ferais un petit effort avec les mêmes
capacités: enlevage à 1'35 moyen 250m et 1'35 moyen dernier
250m je devrais faire, dans les règles 5 secondes de moins donc
6'35.
l'énergie serait alors 423w*47.5s+ 363w*300s+423w*47.5s=
148065j/392.5s= 378watts moyens = +3.5% au total 7.5% de plus pris sur
de l'annaérobie
dans mon cas un 2000 est fait à
96% aérobie 4% à 8% anaérobie!
si avec les même capacité aérobie
(VO2max PMA et tout le touin touin) représentaient 80% de ma puissance
au 2000, je devrais donc avoir à peu près 425 watts soit
de quoi faire 6'20 à l'ergo 7'03 sur l'eau! (on voit sur la liste
des temps que ça serait carrément bien: les temps au dessus
sont ceux de grands champions qui n'ont pas atteint leur limites (en juin
ils doivent faire mieux, du genre 6'11 justement): examiner leur valeurs
donne idée du mieux à faire...
il s'agit la des limites humaines pour un âge
déjà avancé (35 ans 72 Kg)
Comparons avec xavier Dorfman qui est moins sénile,
il est juste au maximum (près de 30 ans) Date de naissance, 12 mai
1973. Taille, 1m82 71 kg. ... avec 20% d'anaérobie sans doute,
il me met 20 secondes dans la vue (6'16.5 soit 435 watts soit 3% de plus
que j'espère pouvoir avoir: cette diférence est due à
l'age: il est recconu que la puissance décroît de 1% par an...
il ya 5 ans d'écart, peut être que Xavier est seulement à
2% des limites?)
il est donc peu probable que j'arrive au même
niveau: compte tenu de l'âge il faudrait en fait être meilleur.
mais l'exemple du suédois qui a mis 6'01 alors que le records habituel
est 6'10 montre qu'avec le recours à l'ananérobie on peut
éloigner les limites: reste à savoir si c'est possible "pour
tous" (en travaillant), ou que ce dernier écart est du à
des différences génétiques. pour ma part l'inacessible
se situerait au dela de 6'20 ergo: +10 ans (35 = 25+10) + 10 secondes d'handicap..
Ce n'est pas de traîner mon skiff julien
(une enclume à rames) 3000 km de plus qui me fera progresser ainsi,
au point d'atteindre 425w moyens sur un 2000 (on me l'avait dit d'ailleurs
depuis longtemps) (la progression seulement aérobie serait de 3%
par an à la rigueur soit 0.001% par km mais aussi perte de 1 à
2% par an cause sénilité différence 1 à 2%/an)
il me faudra squatter le skiff de course et faire des séries, et
tous les exercices très spécifiques... car là il reste
16% à gagner et cela peut être fait en deux ans. Même
ainsi il serait bien improbable que je fasse les performances limites:
ça voudrait dire que je suis champion olympique, mais théoriquement
c'est possible, Le temps que j'accomplisse ce gain en anaérobie,
je serais encore plus âgé (37, 38 ans?) alors je me ne serait
compétitif alors que par rapport aux vieux croûtons de mon
âge, vive la vieillesse.
remarque: les puissances paraisssent modestes
car il s'agit d'ergomètre rameurs: les cyclistes retrouveronts des
puissances habituelles en ajoutant 50 watts ou même 60 (cadences
elevés)
Les processus énergétiques
En stock immédiatement disponible: l'ATP est la monnaie d'échange
énergétiques: cette molécule transporte l'énergie
au sein de la cellule..
ATP: 1s 5 miliMole/Kg
PC (phosphocréatine) 20 miliMole/Kg 5 secondes d'effort
pour faire au fur et à mesure l'ATP + PC
Glucides
Il est évident qu'il faut reconstituer à mesure cette
disponibilité, et ce à partir du glucose sanguin.
celui ci est fait à partir du Glycogène musculaire: glycogenèse:
400 à 600g donc de quoi tenir 1h à 1h30 (2h40
en cas d'entraînement spécifique en vue d'épreuve cycliste
ou de course à pieds)
Travailler à 65% de la FC max(180-200)
est favorable à la perte de poids car on carbure essentiellement
sur les lipides (FC120-130)
les efforts vers 80% de la FC max (FC 146-160)
et encore plus au dessus font appel au glycogène. 80% est équivalent
du B1. En aviron on utilise peu la lipolyse.
Lipides:
la lipolyse permet les effort prolongés jusqu'à 76 heures
maxi (c'est bizarre, en "théorie" ça devrait faire plus:
essayez donc pour voir)
la protéolyse tire en extrême besoin de l'énergie
à partir de la structure même des muscles: c'est de la démusculation!
(il
y avait des bon centres de démusculation en 1944 en allemagne, il
restait pourtant encore des lipides, pour faire du savon, il paraît:
voir image des fours crématoires en action vu d'avion, sur
http://evidenceincamera.co.uk
) qui est maintenant mystérieusement redirigé vers http://www.esolution.co.uk/html/home.htm
qui n'est qu'un machin à la con publicitaire)
Substrats énergétiques
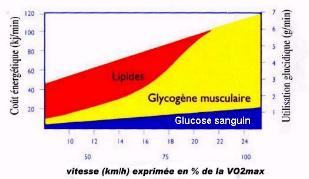
cette image montre que l'endurance douce brûle
des lipides, mais l'aviron est essentiellement basé sur les sucres
(glycogène musculaire) Les séances de B1 à 75% de
la VO2max seulement font appel aux lipides, dans une proportion d'un tiers
lipides, 2/3 glycogène.
pour redevenir poids léger (maigrir) il
faut faire des séances d'endurances souvent, moins intenses que
le B1: vélo tranquille, longtemps, grandes marches...
Je l'ai constaté: travailler essentiellement
vers 80% de sa FCmax (ou de la VO2max) fait grossir.
- car on ne touche pas aux réserves de
lipides
- car l'effort plus intense, faisant diminuer
les réserves de glycogène donne plus faim
- car à 80% d'effort on brûle moins
de calories au final puisque l'effort, intense n'est pas poursuivi très
longtemps.
Par exemple, pour brûler 3000 kcal/jour
sans fatigue, plusieurs jours de suite (en plus du métabolisme de
base) il faut rester entre 60 et 65% de sa VO2 max (coeur entre 110 et
130 pulses)
Maigrir ainsi est délicat: on se désentraîne.
Ce que j'essaie de faire est donc, puisque que l'on n'est pas fatigué
après des efforts aussi modérés, d'ajouter un B1 de
30 à 60 minutes en fin de journée. Mieux encore, alterner
les séances avec carburation lipides avec les autres plus dures:
ainsi se reposer en tirant moins 2 jours sur 3 par exemple. Si les B1 on
les fait comme il faut, à 16 de cadence, on prend de la masse musculaire,
ainsi le poids ne descend pas, il reste stable. (pour ma part je fait 1
Kg de trop pour être poids léger, en février 2004,
je préfère donc courir en TC, avec peut être , pourtant,
le skiff de fillette, car je sais que mon poids minimal n'est atteint qu'en
été ou je descend à 70 Kg, ce qui fait avionner en
vélo)
Alterner les séance douces (<75%) avec
des entraînements durs permet à la fois de brûler les
lipides (donc d'accroître sa capacité à durer et à
maigrir) et permet d'accumuler le glycogène, et aussi se reposer
pour les entraînements durs 1 jours/deux ou trois. Faire tous les
jours des efforts intenses est une erreur: cela mène au sur-entraînement.
2 sortes de sur entraînement: le parasympatique
et le sympatique. La persepective d'en subir l'un ou l'autre n'est pourtant
pas sympatique du tout.
en résumé:
si on perds du poids, que l'on dort mal la nuit
et qu'on est agité, que le coeur tape la nuit, c'est la forme sympatique
Si on a plus envie de se taper une queue, qu'on
ne salit plus sa culotte, mais qu'on ruine normalement le frigo et que
l'on dort c'est la forme parasympatique (voir plus loin un bla bla plus
"offiçiel")
Je suis lourd en hiver, léger en été,
pour plusieurs raisons
en hiver, je fais des séances plus intenses
et plus courtes, car il fait moins chaud (plus intense ne fait pas crever
de chaud) et les jours sont plus court: je n'ai pas le temps par exemple
de me taper 50 bornes de kayak ou 10 heures de marches: en fait l'hiver
il ne reste que les séances dures, rarement en dessous de 140 pulses
(pour un max de 183 donc 75%), en hiver je brûle entre 1000 et 3000
kcal/jour, mais en moyenne 1500 et ce essentiellement sur les sucres...
En été, je part parfois 8 heures
de suite et je suis en général en dessous de 120 pulses (même
si il y'a parfois 1h ou deux à 150 pulses, genre montée d'un
col), ainsi je carbure essentiellement sur les lipides, avec une dépense
calorique atteignant parfois 5000 kcal en une journée...
Les substrat énergtéiques sont transformé en glucose
qui est ensuite transformé en PC puis ATP (monnaie d'échange
énergétique) de différentes façon: sans oxygène
anaérobie et avec oxygène aérobie
sans oxygène anaérobie
1 molécule de glucose donne 2 ATP
il est produit des lactates. qui par suite de réaction secondaires
rendent acide le muscle.
avec oxygène aérobie
1 molécule de glucose donne 38 ATP
flux d'énergie métaboliques
les premières secondes 6.3kw ATP+PC
de 0 à 2 mn 30 avec maxi à 10s Anaérobie lactique
maxi vers 5 kW
Croissant graduellement jusqu'à 6 minutes environ, aérobie:
flux maxi 2kw environ, décroît ainsi peu à peu et se
stabilise vers 1000 watts.
pour avoir idée des puissance mécaniques divisez ces
valeurs par 4 environ (rendement musculaire 25%)
ainsi on a 1.5 kilowatts sur une série
de 3 coups de pelles
1200 watts sur une série de 10 coups de
pelles (l'ergo devrait afficher alors 1'06 au 500 un bref instant! c'est
possible ça? J.C Roland doit le savoir) Mon neveu me raconte avoir
vu afficher 56' à l'ergo durant quelques coups de pelles (what?!
1965 watts, pourquoi pas 2004 watts tant qu'on y est?).
400 à 600 watts sur un 2000 (6 à
7') (6'15/500m à 5'30 ergo)
250 watts sur les distances très longues
(1'50/500m à l'ergo)
En cyclisme on observe 1100 watts moyen sur le
kilomètre (un peu moins d'une minute) et 2300 watts sur le 200m
lancé environ 15 secondes (l'effort dure le temps de faire 300m
puisqu'il y'a l'accélération avant le repère)
la puissance aérobie est maintenue au dessus de 300 watts durant
plus d'une heure.
Test incrementaux
4 minutes on fait un palier à 150 watts chez les PL (ou 200
sinon) prise à la fin du palier de la FC
30' pause, prise de lactates
4 minutes palier suivant à 50 watts de plus. et ainsi de suite
J.C Roland finit le palier à 550 watts.
on trace la courbe VO2, la courbe lactacémie, la FC et ce en
fonction de la puissance.
il s'agit d'un test rectangulaire.
le test pyramidal plus courant dans les test
d'efforts classique sur ergocycle n'a pas été mentionné
on fait 3 minutes de palier puis on enchaîne
sans pause sur le palier de 3 minutes suivant qui fait 30 watts de plus.
la puissance max est le dernier palier plus 30 watts fois le pourcentage
de temps maintenu pour le palier suivant inachevé. la prise de lactate
est prise en continu.
sur machine à ramer il y a une perte de
0.5 watts par kg de personne: cela est du à l'énergie perdue
dans le déplacement du corps sur une machine à socle fixe.
Pour en avoir le coeur net j'ai mis une montre cardio et relevé
la fréquence cardiaque à une puissance donnée, sur
machine à ramer. je trouve toujours à cette même FC
entre 30 watts et 40 watts de plus en vélo en montant les côtes,
sur le terrain en estimant ma puissance en faisant la somme lutte contre
les frottements et lutte contre la pesanteur. il est très facile
de mesurer très précisément la lutte contre la pesanteur:
à 5 watts près voir moins sur une moyenne de 20 minutes,
et sur les vitesse réduites la plage d'erreur de 5% environ est
réduite à 1 watts environ en dessous de 16 km/h. J'ai retrouvé
cette différence en essayant des ergomètres vélo au
pôle. Depuis 2 ans cette différence s'avère constante.
Pour ma part je pratique à peu près autant le vélo
que l'aviron et je fonctionne totalement en aérobie, ce qui donne
des mesures reproductibles )
masse grasse
8% chez un PL et de 8 à 12% chez un TC
en dessous de 8% de masse maigre on perd de la performance (perte de
puissance pure)
car ces 8% ne sont pas de la couenne mais sont
stockés dans les muscles.
Masse = MasseGrasse+ MasseMaigre
MasseGrasse/Masse = 8% = 0.08
MasseMaigre= Masse - %MasseGrasse*masse
Masse= masseMaigre*(100-8)*100
Si on a une masse maigre de 76 Kg il ne faut
être entre 82.6 Kg et 86.36 kg
Si on a une masse maigre de 66 Kg il ne faut
pas descendre en dessous de 71.7 Kg
au dessus de 67 Kg de masse maigre on doit donc
en principe dégrader ses performances pour entrer dans la catégorie
"poids légers"<72.5 Kg. La masse maigre augmente avec la
quantité de muscle, ainsi quand on se trouve dans les 72 à
75 Kg il faut choisir d'abord savoir si on peut descendre à 72 tout
en en conservant 8% de masse grasse, et entre deux stratégies: miser
sur la performance en endurance et la régularité ou prendre
du poids utile en faisant de la musculation et en gagnant donc la puissance
anaérobie qui permettra de ne pas se faire larguer. celui qui a
juste 72 Kg avec 8% de masse grasse est le plus avantagé en PL.
B1 et B2 les entraînement de fond sont l'essentiel des entraînements.
Les intensité supérieures sont spécifiques et utilisés
à peu près le dixième du temps.
le B1 est un exercice à <2 mMoles de lactates par heure
le B2 à 3
concrètement: B1 c'est ramer à 90% de la force de compétition
mais à 16-18 de cadence (36 en compétition) donc
à 50% de la puissance de compétition. un B1 se fait entre
12 et 13 km/h (peut être un peu plus sur des bon skiff, mais aussi
en vélo, footing ou autre activité physique, et ce durant
une heure ou deux: la fréquence cardiaque est 70 à 80% de
la FCM (80% chez ceux qui ont un "seuil" très décalé
sur la droite:
B2 c'est ramer à 20 de cadence à 85% de sa FCM environ,
durant 20 minutes à 30 minutes.
un bon B1 ou B2 est quand on a fait un maximum de km en donnant le
moins de coups de rames possibles.
Ces façons de ramer nous proviennent des méthodes des
allemandes de l'est. les américains et les italiens cumulent plutôt
des fractionnés: ils rament presque jamais en dessous de 24 de cadence
et n'ont pas "la patience" de se taper des bornes. Cumuler de l'endurance
semble plus solide à long terme.
Ces méthodes amènent moins de monde sur le podium pour
une quantité équivalente de rameurs.
Le B1 est aussi essentiel à la "prioceptivité". on acquiert
mieux la technique. On assure le transfert entre cadences lentes et cadences
rapides en incluant des séries dans un entraînement à
cadence lente: séances B1/B6 ou B1/B5
B1/B6 on fait un sprint à fond de 30 secondes
toutes les 10 minutes et on revient à la vitesse de croisière
B1/B5 on fait un 500m à fond (1'45 environ)
toutes les 20 ou 30 minutes.
à remarquer la similitude avec les sprints
placés dans les sorties d'endurance en vélo.
Ces séances assurent un "transfert" de la précision des
cadence lente vers les cadences élevées mais aussi permettent
à l'organisme de s'habituer au changement de rythme: la fréquence
cardiaque se stabilisera plus vite vers le maximum, ce qui ajoute de la
puissance aérobie et évite l'accumulation de lactates en
début d'effort, ou en début de hausse d'effort (départ,
séries et enlevage)
régulation thermique
Faire de l'ergo en salle ne doit pas provoquer un emballement thermique:
il est courant de voir des rameurs suants à l'ergo tant et si bien
que leur température interne dépasse 39.5° et qu'il perdent
1.5 litres par demi heure. il s'agit de conditions extrêmes que l'on
rencontre chez les marathoniens en fin de compétition en été
et qui sont une agression qui épuiserait l'organisme si elles se
répètent au quotidien! or on devrait faire 1 à 2 séances
de B1 chaque jour!
la FC monte de 10 pulses par excès de
chaleur: cela fait 30 watts de moins pour une même FC
en faisant un B2 à 1'50 de moyenne au
500, on a une chaleur excédentaire proche de 1000 watts: un petit
poêle à pétrole à l'intérieur du corps!
de quoi se sentir très bien torse nu à 0° mais très
mal dans une salle chauffée à 15° non ventilée,
même à poil, personnellement j'évite l'ergo en dessus
de 5°, et je ne fais pas de B2 en dessus de 0° en me mettant pourtant
torse nu et dehors
Si il faut ramer dans une salle d'ergo chauffée,
je choisi le plus efficace et le moins cruel: de rester en vélo
dehors, à 36 km/h ou l'ergo personnel, afin de privilégier
un entraînement à forte charge tout en ayant la FC dans la
fourchette conseillée... c'est ainsi que je fait des B1 à
1'53, des B2 à 1'49 alors qu'en salle les B1 c'est 2'00 et les B2
1'55 en ayant un slip trempé qui provoque la macération des
burnes.
je pense que fractionner un B1 ou un B2 est néfaste,
il faut mieux alors aller courir ou faire du vélo. Parfois je maintient
la fréquence cardiaque dans la fourchette mais alterne footing et
ergo, le footing servant à se ventiler un bon coup! Comme il est
difficile de faire ça au sein du club, à moins de transpirer
comme un phoque et de prendre froid après en vélo je fais
ça chez moi, et au club alors on croit que je glande...
En été? je m'entraîne à
l'aube en nageant tous les 5 km dans l'eau qui entoure le skiff (je considère
alors la nage comme une continuation de l'entraînement aérobie
je garde le rythme cardiaque) et je fais du vélo la nuit (surtout
en 2003!)
Il faut en tenue légère
et il a été
proposé, dans les salles chauffé même vers 14°
ajouter des ventilateurs. ce qui faut veiller: à ne pas prendre
trop chaud (se dévêtir après
échauffement sans attendre que l'on soit suintant) mais aussi
à ne pas prendre froid (se vêtir 30 secondes après
la fin de l'effort, se vêtir et rentrer le bateau ensuite par exemple)
Il faut particulièrement veiller à la bonne régulation
thermique lors des séances de B2 et B1 qui permettent l'accumulation
de chaleur. comme la FC s'emballe avec la chaleur en cas de surchauffe
le plan d'entraînement (basé sur le respect d'une fréquence
cardiaque) ne peut pas être suivi dans de bonnes conditions. L'hypothalamus
tente de faire diminuer l'effort: c'est plus dur. et une partie du sang
est détourné vers la périphérie pour l'irrigation.
L'entraînement
est alors inefficace musculairement (si respect de la FC, diminution de
la charge musculaire) ou surcharge les capacités cardio-vasculaire
(FC trop élevée pour un même effort). la perte
hydrique peut atteindre 1.5Kg par demi heure: on ne peut pas s'entraîner
correctement dans ces conditions: faire de l'ergo dans une salle chauffée
est une erreur souvent répandue.
En ergo dehors torse nu par 2° on a pas froid,
attention cependant: si on a une puissance moyenne suffisante pour provoquer
un tel métabolisme.
Un non entraîné ne parviendra pas
à tenir la puissance suffisante pour s'échauffer. Le rapport
est du simple au double en puissance thermique.
en bateau il faut veiller à avoir la tenue appropriée:
un débutant devra être bien vêtu, ainsi que la plupart
des loisirs, mais un rameur de haut niveau sera généralement
en tenue légère même en hiver. s'habiller
plus ne sert qu'à être totalement mouillé pas ses exsudats
et à prendre froids à la fin de l'entraînement en étant
aussi mouillé que si on était passé à l'eau.
Attention à la pudeur: en salle
on est en société on met une combinaison plutôt que
d'être torse nu avec son corps répugnant huilé de ses
exsudats, pour pas choquer les autres pour pas exhaler des puanteurs de
dessous les bras, pour pas dégouliner sur les sièges, en
foutre partout: faut souffrir sans que ça se voit... (pour ce qui
est dit pour torse nu, retrancher encore 2 ou 3°!) amener un maillot
que l'on mouillera jusqu'à la moindre fibre puis qu'on changera.
Ce maillot sera bon pour le lavage en une séance, pourrira dans
les sacoches au retour du club, et fera tourner une machine à laver...
Sur l'eau on ne rame jamais torse nu,
ça fait pas sérieux: ça fait plage, vacance, pas digne
d'un sport très sélect, de snobs ou d'élites distinguées
ramant en pantalon et chemise à Oxford (l'aviron hérite de
cet état d'esprit des années 1800: y'a pas à chier
ça fait beau... alors des types à poil la dessus ça
fait décadence... un rameur se récoltera sur son beau
corps d'athlète le bronzage agricole avec les bretelles de la combine
bien blanches sur ses épaules... le fantôme de la combine
le hantera alors à la plage et il se sentira tout con avec son coup
de soleil...
effets de l'entraînement
En haut niveau on progresse généralement de 3% par an
en VO2max.
La VO2max habituellement observée chez l'élite est exprimé
en litres/minute est n'est pas rapportée au poids. on observe généralement
5 à 6 litres/minute.
en effet le poids est un facteur de performance:
à rapport puissance sur poids égal, un lourd va plus vite.
à puissance égale cependant un lourd est handicapé
de 1.2 secondes par kg (1.5% de gain de poids = perte de vitesse de 0.28%
= puissance+0.85% pour compenser donc réduction de puissance/poids
nécessaire pour même vitesse 0.85/1.5= 0.56% par kg ainsi
si on fait 6 à 70 Kg (420 watts) on serait a égalité
avec quelqu'un qui fait 5.06 à 100 Kg (506 watts ).
L'entraînement décale aussi les seuils vers les fréquences
cardiaques élevées:
par exemple, si avec la même VO2 les seuils se décalent,
on dispose de plus de puissance pour ces mêmes seuils, et on utilise
plus longtemps sans fatigue des fréquences cardiaques élevés.
JC Roland n'a plus rien gagné en VO2 depuis 1992 mais il progresse
encore: il a acquis en fait en capacité aérobie (le pourcentage
de puissance de VO2max disponible sans cumul de lactates)
elle est hors norme: 99% (il peut être à 99% de sa VO2max
sans faire de lactates)
le meilleur habituel est 92% et chez le sportif ordinaire 65
pour une FC max de | 180 | 200 |
99%= seuil à
| 178 | 198 |
92% seuil à
| 165 | 184 |
65% seuil à
| 117 | 130 |
L'entraînement diminue la production de lactate, une sorte de
fibre musculaire est favorisé, des fibres oxydatives qui utilisent
les lactates comme carburant.
On progresse pas quand on fait l'effort, mais
pendant la récupération. C'est en récupérant
de la fatigue provoquée par un entraînement que l'organisme
se modifie pour être plus performant. ce qui influe le plus sur l'efficacité
des entraînements est l'espacement optimal, pas trop rapproché,
mais pas trop loin non plus. Trop rapproché on se sur entraîne,
et trop éloigné on s'entraîne pas réellement.
Cette notion ressemble un peu à celle de surcompensation. l'entraînement
est en fait une sorte de surcompensation générale, cumulée
sur plusieures années. La surcompensation proprement dite est le
phénomène de stockage de glycogène plus important
2 à 3 jours après un effort qui a vidé les réserves:
on a jusqu'à 2 fois plus de glycogène que le niveau normal.
Cette acumulation peut être poussée au maximum avec les régimes
dissociés.
Symptômes physiologiques du syndrome de surentraînement
* Forme classique (sympathique):
- baisse des performances,
- fatigue persistante,
- agitation,
- troubles du sommeil,
- perte de poids, anorexie,
- augmentation de la Fc et de la pression artérielle
de repos,
- récupération de la Fc et de la
pression artérielle plus lente après un effort,
- hypotension posturale,
- infections fréquentes,
- diminution de la lactatémie maximal
à l'effort,
- perte de l'esprit de compétition.
* Forme moderne (parasympathique):
- baisse des performances,
- fatigue persistante,
- dépression, lassitude
- sommeil non perturbé,
- poids et appétit normal,
- baisse de la Fc de repos avec récupération
rapide après effort,
- hypoglycémie à l'effort,
- infections fréquentes,
- diminution de la lactatémie pour des
efforts modérés et maximaux,
- diminution de la libido chez les hommes et
aménorrhée (arrêt des règles) chez les femmes,
- perte de l'esprit de compétition.
(texte en marron: extrait de http://physiomax.com.free.fr/
)
Schématiquement comme on peut le voir,
un muscle qui travaille puise son énergie préférentiellement
dans les lipides lors d'un exercice modéré (< 50 % de
la VO2max), et capte son énergie dans les glucides lorsque l'intensité
augmente. Ainsi la molécule de lactate est un intermédiaire
majeur du métabolisme oxydatif et de la glycogénolyse. Au
cours d'un exercice musculaire, la glycolyse augmente et entraîne
une production importante de lactate liée au recrutement des fibres
glycolytiques de type IIb (rapides).
La théorie de la navette du lactate suppose
un échange de ce métabolite avec la circulation sanguine,
mais aussi avec les fibres musculaires oxydatives (I (lentes) et
IIb (rapide), qui se chargent de l'oxyder. Le muscle est donc capable à
la fois de produire et de libérer du lactate, mais aussi de le réutiliser
comme substrat énergétique.
(texte en marron: extrait de http://physiomax.com.free.fr/
)
Ainsi cet intermédiaire métabolique peut servir de réserve
énergétique au même titre que le glycogène.
La VO2 n'est pas seulement augmentée par le volume cardiaque:
c'est la capilliarisation dans le muscle qui fait que celui puise plus
d'oxygène...
L'augmentation de la densité, de la taille et même de
l'emplacement des mitochondries dans les cellules. les mitochondries seraient
plus près de la membrane cellulaire
L'endurance convertit la plupart des fibres musculaires en fibres rouges
qui sont rouges car riches en myoglobine transportant l'oxygène,
ce sont ces fibres qui servent essentiellement à l'aviron...
Suivi d'un entraînement: on veillera à respecter la régulation
thermique (pas trop vêtus pour les entraînements sur l'eau,
en petite tenue dans une salle froide pour l'ergo) et on fera régulièrement
des tests rectangulaires avec mise en graphique de la relation FC-puissance.
exemple de relation FC puissance, ici dans une
épreuve triangulaire
 image:
sur chaque palier on note la puissance lue en fonction de la FC
image:
sur chaque palier on note la puissance lue en fonction de la FC
Le premier palier fait 5 minutes, les autres
3.
on note donc par exemple au palier 250 watts,
réel 251 watts et FC 156 la première minute réel 256
et FC= 166 la deuxième minute, et enfin 252 FC 166
Remarque ce cycliste disait:
je faisais 84.5 kg le jour du test.
Pour info, vers chez moi il y a une côte
de 8.5 km pour 450 m D+, je la
monte sans trop forcer (puls sous 170) en 30
minutes avec un vélo de 9 kg.
j'en déduisait "si la cote est régulière
montée à 16.5km/h ça ferait
résistance de roulement
45 watts
lutte contre la pesanteur
229 watts
total 274 watts moyen."
Sur le test d'effort, on remarque que à
FC 170 la puissance est entre 250 watts et 275 watts. c'est pas loin de
l'estimation
SEUILS PHYSIOLOGIQUES
La notion de "seuil" dans la physiologie du
sport moderne permet d'évaluer le niveau d'effort au-delà
duquel les besoins corporels en énergie sont modifiés. On
parle alors de seuils ventilatoires. Ces derniers vont ainsi permettre
de mesurer l'adaptation ou l'inadaptation d'un athlète au cours
d'une épreuve maximale. " texte en marron: extrait de http://physiomax.com.free.fr/
)
"seuil1 seuil2 seuil3"
seuil 1: le seuil où l'on dépasse juste 1 mole de lactate/kg/h"
en haut niveau on sort souvent la phrase suivante à un rameur
"tu va me faire cet entraînement au seuil 2"
avec les test d'effort il sait à quelle fréquence ou
quelle vitesse ça correspond, il travaille donc à la fréquence
cardiaque.
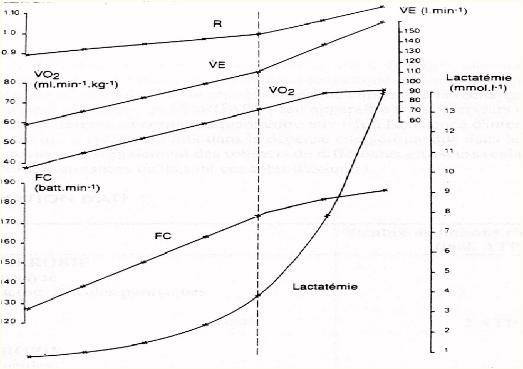
Ici le seuil 4 correspond à une FC de 170. On
remarque qu'au seuil 4 VE change de pente: ça correspond au premier
seuil ventilatoire.
Le seuil 2 est vers FC 110. L'entraînement
décale les seuils vers la droite.
B1 et B2 les entraînement de fond sont l'essentiel des entraînements.
Les intensité supérieures sont spécifiques et utilisés
à peu près le dixième du temps.
le B1 est un exercice à <2 mMoles de lactates par heure (sur
cet exemple: le coeur à 150) vitesse
en bateau12-13km/h
le B2 à 3 (sur cet exemple le coeur à 162) vitesse
14 14.5km/h
le B3 entre 4 et 8 (coeur à 170-175) vitesse
15-15.5km/h
cette image correspond à un athlète
endurant de haut niveau!!! la VO2max est entre 40 et 50 pour le sportif
non confirmé, ici c'est 80.
En Aviron on a coutume (pour des fréquence cardiaques maximales
de 190-200 comme sur cette image, de placer le B1 entre 142-152, le B2
entre 152-168. Il s'agit dans ce cas de valeurs adaptée à
des rameurs confirmés qui ONT DÉCALÉ LES SEUILS VERS
LA DROITE . Si on mesurait les lacates on constaterait bien souvent que
les B1 en club sont souvent fait bien trop intense, d'où un épuisement
progressif si on fait les 1 ou 2 B1 chaque jours. Si on sort de B1 avec
3 de lactates c'est pas normal
vélo: ce qui est impressionnant est la pharmacie: les cyclistes
ont plus de médicaments que de nécessaire d'entretien du
vélo. ces médicaments sont dans les moeurs:
en vélo on se soigne contre une étrange maladie: la fatigue
et le manque de puissance par rapport à un moteur.
Seuils
les tests incrémentaux permettent de déterminer
les seuils d'efforts: seuils lactiques et seuils ventilatoires
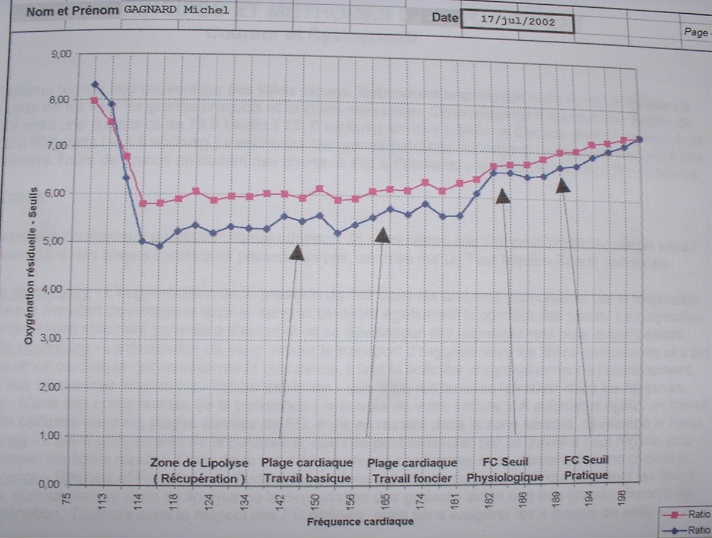 image:
en rouge le CO2 rejeté, en Bleu l'O2 consommé
image:
en rouge le CO2 rejeté, en Bleu l'O2 consommé
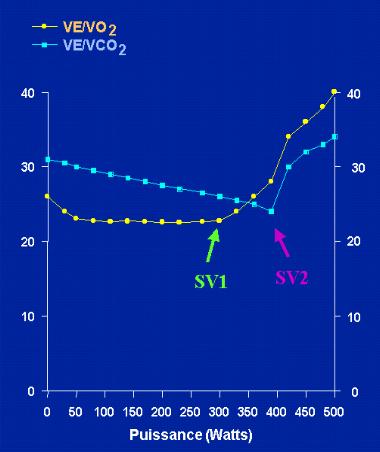 Comment
sont trouvés les seuils (il s'agit des seuils ventilatoires et non
des seuils lactiques)
Comment
sont trouvés les seuils (il s'agit des seuils ventilatoires et non
des seuils lactiques)
- La méthode de "Wasserman", est basée
sur les équivalents respiratoires en oxygène (VE/VO2) et
en dioxyde de carbone (VE/VCO2). Ces derniers sont le rapport de la ventilation
(l/min) sur la quantité d'O2 ou de CO2 échangée (l/min).
Pour déterminer SV1, on note l'élévation
du rapport VE/VO2 sans augmentation concomitante du rapport VE/VCO2.
Dans ces conditions, l'augmentation de VE/VO2, indique que l'élévation
de la ventilation (VE) pour éliminer le CO2 est disproportionnée
par rapport aux besoins de l'organisme en O2.
Pour déterminer SV2, on note l'élévation
du rapport VE/VCO2. On préférera utiliser cette méthode
à celle de Beaver, pour déterminer SV2.
Dans les deux cas, la lecture de la ventilation
(représentée par une cassure nette), nous aide à affiner
la détermination de ces seuils.
(extrait de http://physiomax.com.free.fr/les_seuils_ventilatoires____.htm)
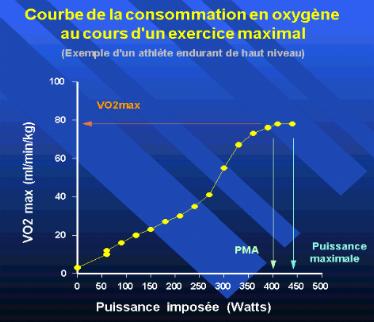
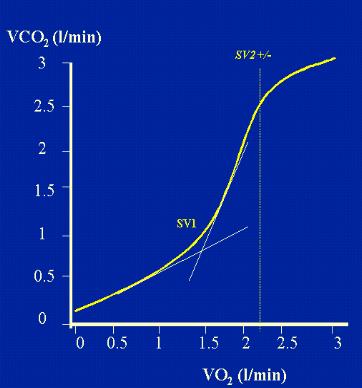
On observe sur la courbe de la VO2 une
cassure de la pente. elle correspond à un seuil. je pense que le
graphique de gauche est "faux" en fait, ici au dessus de 300 watts
la VO2 semble augmenter plus vite que la puissance, ce qui indique une
baisse de puissance pour une un même rapport de quantité d'O2
consommée. Or c'est le contraire: quand on dépasse le seuil
aérobie anaérobie, le surcroît de puissance est fais
sans oxygène, le ration puissance/VO2 est donc augmenté(
puissance plus élevée que prévue): la courbe au lieu
d'augmenter de pente devrait au contraire tendre à diminuer (voir
l'image du haut de la page, c'est l'inverse. Je pense que si ce graphique
est juste, que le rendement baisse brutalement, peut être à
cause du surcroît d'énergie consommé par l'hyperventilation:
le type doit souffler comme un soufflet de forge. SV1
représenterait le "seuil d'adaptation ventilatoire".
Ce dernier est un bon indice de la capacité
endurante (aérobie) ou autrement dit de l'endurance maximale aérobie.
En travaillant au-dessus de SV1, on travaille efficacement son endurance.
Il sert aussi de référence pour ré-entraîner
certains malades (insuffisants cardiaques, diabétiques, asthmatiques,
...).
Chez un sportif "endurant", SV1 se situe au-delà
de 55 % de la VO2max.
SV2 représenterait le "seuil d'inadaptation
ventilatoire".
Ce dernier associé à la VO2max,
permet donc une meilleure conduite et un meilleur suivi de l'entraînement.
Ainsi, en travaillant au-dessus de SV2, on va pouvoir programmer des séances
de fractionnés ciblées sur la filière dite "anaérobie".
Chez un sportif, SV2 se situe au-delà de
80 % de la VO2max.
Apprentissage moteur.
on utilisera surtout les séances B1 pour s'enfoncer dans la
moelle épinière l'aptitude à ramer sans spalaflouche.
On ne fait jamais de B4 en plein hiver ça accentue les risques et
aussi les écarts thermiques.
la technique est la première des préoccupations
ramer correctement en sous cadence
optimiser la force
favoriser les conditions de perfectionnement ultérieur
Lorsque qu'on maîtrise la technique on se sent sur (notion de
certitude du bon geste)
on dépense la moins d'énergie possible (la FC est plus
basse à vitesse égale, et à puissance maxi on va plus
vite)
quand on est motivé, passionné, l'intérêt
permet d'assimiler, d'intégrer les notions qu'on apprend. apprendre
ne suffit pas, ça s'efface, apprendre plus intégrer rentre
dans le ciboulot.
Pour créer l'intérêt il faut rendre passionnant
l'aviron à ses émules. il ne faut pas mettre la pression
trot tôt sur les minimes, par exemple d'où la suppression
des championnats de benjamins et de minimes.
si on médite ça aide aussi, la
méditation de l'attention continue est consiste en effet a avoir
artificiellement un intérêt pour un sujet quel qu'il soit,
c'est utile pour rester concentré sur un sujet mais aussi pour s'y
intéresser réellement. Le sujet d'apprentissage du shiné
est tout simplement s'intéresser continuellement, comme si c'était
passionnant, à l'air qui rentre et qui sort de son bout du nez,
et ce durant 8 h/jour. Un des progrès les plus importants (gain
de près d'un km/heure) ont été permis par l'application
de la méditation shiné (appris dans un centre bouddhiste)
à la ramerie: je plafonnais à 14.2 km/h avec mon jullien,
de retour du monastère j'ai pu dépasser 15 km/h. sans la
méditation je n'aurait jamais eu un niveau acceptable et surtout
pas eu l'aptitude à corriger mes défauts. Pour les défauts
c'est la technique de "la vision pénétrante" qu'il faut utiliser
(conscience ouverte sans jugement: on constate tout ce qui se passe, sans
occultation, ça permet de constater ce qui serait inconscient sinon).
La méditation permet de ramer correctement alors qu'on apprend tout
seul, sans cela je pense que acquérir une ramerie correcte en autodidacte
est quasiment impossible. J'ajoute que la ramerie peut être "correcte"
mais restera encore insuffisante pour rivaliser au moins techniquement
avec le haut niveau. là il faut une prise en main, un entraîneur.
Habilité ouverte: football (on est à l'affût de
ce qui arrive)
habilité fermé (aviron: on rame
comme un sourd)
lire le bouquin de schmith "apprentissage moteur" des éditions
vigo (vérifier l'eaurtografe)
habilité discrète (tir à l'arc, tir de javelot:
il y a une préparation, un début, et une fin)
habilité sérielle (gymnastique: enchaînements de
séquences de mouvement)
habilité continue (l'aviron, bien que on pourrait décomposer
les mouvement, mais il n'en est pas ainsi chez le rameur confirmé)
Lorsqu'un rameur vient: se renseigner sur son passé sportif:
il peut avoir acquis des habilités favorables à l'aviron.
coordination de la natation et habilité à pousser dans l'eau
particulièrement favorable
En haut niveau, la manière de ramer est la carte de visite de
l'entraîneur qui a formé les rameurs.
étapes de l'apprentissage
connectivo verbale
durée entre une semaine et un mois: le gosse pense avec des mots
pour se dire ce qu'il doit faire pour avancer sans nécessairement
se baigner et avoir la honte.
il ne faut pas dire directement ce qu'il doit faire, mais lui faire
comprendre ce qui foire dans ce qu'il fait: c'est plus long au début
mais plus efficace ensuite: exemple "regarde ta hauteur de main, augmente
là, réduit là, qu'est ce qui se passe. croit tu que
tu va avoir l'équilibre si tu met tes mains comme cela...
Chez les minimes la capacité d'attention globale limitée
(cela se constate par une moins grande performance de la vision périphérique)
Il vaut mieux au début ne pas être trop pointilleux, cela
brusque les choses et peut ralentir à long terme la progression.
chez les minimes il faut pas les démotiver, l'aviron doit rester
ludique. il est important de leur faire lever du sol une barre (légère),
car cela donne une bonne idée de l'enchaînement jambes corps
bras à faire sur le bateau (ramer est faire des épaulés
horizontalement!)
En été il est bien de laisser tomber à l'eau les
gamins et même de les inviter à le faire: il sauront comment
remonter sur le bateaux est rentrer: c'est même le premier truc de
sécurité qu'il faudrait leur apprendre. en plus ils seraient
plus sur d'eux et donc apprennent sans se bloquer.
étape motrice
6 à 7 mois et parfois 1 ans
C'est la période d'intégration (2 à 3 fois par
semaine nécessaire)
Il faut suivre le rameur pour le corriger, il faut mettre en valeur
3 qualités pour un défaut, afin de ne pas le démotiver:
tu fais ça , c'est très bien, et puis t'a amélioré
ça, mais par contre regarde, il faudrait que tu corrige ça.
Les "loisirs" doivent disposer d'un matériel digne de
la compétition au niveau des réglages.
La ramerie est acquise, mais c'est aussi là que se fixe les
défauts et que les bateaux mal réglés peuvent être
désastreux. Il faut être aussi pointilleux, sinon plus sur
les bateaux des débutants que sur ceux de compétition:
il est absurde de faire ramer des débutant et des loisirs sur des
bateaux qu'on n'aimerait pas utiliser. qu'ils soient plus lourds ne fait
qu'une différence imperceptible de vitesse (il faut des repères
pour mesurer) mais la position et les sensations doivent être
les mêmes que sur un "vrai" bateau! Un bateau mal réglé
peut faire des tendinites ce qui signifie 6 mois d'arrêt, comme en
vélo, il y font attention à leur cales (tiens!
ça me rappelle le skiff bleu). C'est
les débutants et loisirs qui sont exposés à ce genre
de mésaventures qui sont du à des négligences. Un
rameur de compétition n'y est pas exposé, il ne ramera pas
sur un bateau mal réglé.
Les loisirs peuvent être motivé
et être de futurs compétiteurs. Il est courant de considérer
les loisirs comme des rameurs bas de gammes, des rameurs inférieurs.
en faisant ainsi on brise des motivations.
C'est à mon avis (et de l'avis de l'intervenant
aussi, du moins je crois) un des plus gros problèmes des clubs:
négliger le matériel des débutant, pire même
négliger aussi sur le plan social "les loisirs" comme si ils ne
"méritaient" pas un bateau correct, voir un enseignement digne d'un
potentiel compétiteur que peut devenir un loisir motivé.
Moi même a été sujet à
ce problème: en loisir dans un club je disposais de bateau d'entraînements
véga "ailes d'avions" dont les portants sont trop flexibles, et
empêchent l'intégration des sensations sur l'attaque et l'arrière:
un vieux Julien est infiniment mieux. Quand je parlais de "tenter la compète"
c'est tout juste si on n'en rigolait pas: "c'est impossible, tu es trop
vieux, ne rêve pas à ça". Ne peut t'on pas faire de
la compétition à tout âge? J'ai bien sentit qu'on me
regardait de haut. Si je n'avais pas connu l'APP je serais resté
un "loisir". Je vous conseille à vous loisirs de tenter l'expérience
de la compétition, même en ne faisant que 2 courses par an
c'est tout autre...
Pour ce qui est de la tendinite, voulant travailler
l'endurance (donc avoir cadence force suffisante) j'ai eu à cause
d'un bateau qui coulait d'un coté une tendinite en 20 minutes (la
seule de ma vie alors que je fais 3 heure de sport/jours depuis des années),
tendinite m'handicapant 6 mois et au tendon d'achille empêchant les
autres sports d'endurance: vélo, course et marche à pieds:
restait le kayak et taper sur un tam tam.
Les conséquence d'une tendinite sont telles
que si en course je me retrouve avec un tel bateau ça sera tant
pis: je ne forcerait pas.
Certains rameurs acquièrent des défauts
corrigeant des mauvais réglages: par exemple il ne fallait pas changer
l'excès de coiffe bâbords par ce qu'un tel y était
habitué et allait se planter sinon au championnat: ainsi durant
1 an un bateau de compète coulait tribord et il a fallu faire une
tête de rivière ainsi. Je n'ai pu résoudre tout cela
qu'en acquièrant un skiff personnel, très lourd mais sur
lequel je peut m'entraîner. Là c'est excusable (manque
de disponibilité matérielle). Des potentiels compétiteurs
excellents restent des débutant médiocres pour des cumuls
de détails comme cela...
Mon principal professeur à été
la montre cardio plus GPS, et un but à atteindre révélateur
de l'efficacité du geste: la vitesse la plus élevée
possible pour une même fréquence cardiaque. Puis aussi pouvoir
dépasser 15 km/h sans effort surhumains et sans faire des splalaflouch,
au delà de 15 km/h (sur un julien) le moindre défaut technique
rend l'effort saccadé et insoutenable). Les tracés du GPS
et les test d'ergo ont été des preuves de mes capacités
pour acquérir de l'espoir dans la compétition.
Actuellement je découvre l'intérêt
des transferts (voir le chapitre "habilités": transfert des cadences
lentes à élevées, et transferts inter-sports pour
la gestion des puissances d'entraînement. je transfert ainsi entre
le kayak (position assise droite), l'ergomètre (rythmes) , le vélo
(sensations cardiovasculaire et lactiques) la course à pieds (rythme
cardiaque) et l'aviron
étape autonome et automatismes acquis. 1 ans à 3 ans
le cerveau ne participe plus: le geste est automatisé est géré
par des raccourcis neuronaux dans la moelle épinière. Pour
effacer un défaut la seule solution est parfois d'interdire de faire
du bateau durant 6 mois. Les entraînements (musculation, endurance,
sont poursuivis dans d'autres sports). Si le geste est bien acquis, la
ramerie laisse la place totale au reste, on peut ramer alors comme une
machine en se consacrant entièrement à la gestion de l'effort.
pour ma part j'ai constaté des corrections
de défaut tenaces après les reprises suivant les retraites
au monastère ou en montagne, ou après la période hivernale.
maintenant je le sais, c'est le moment de travailler la technique est de
cumuler des exercices afin d'effacer les défaut de la période
précédente, ramer comme un boeuf pour se faire taper le coeur
tout de suite est le meilleur moyen d'attraper de nouveau défauts:
la première semaine de reprise bateau est de la technique d'abords.
à raison de 2 h/jour, je constate une
durée de 15 jours (soit 30 heures) pour revenir à l'automatisation
complète. les défaut alors nécessitant une nouvelle
période sans bateau
pour moi les progrès sont un aller retour
entre "étape motrice" et automatisme.
une autre méthode est de changer de bateau.
les réajustements font alors corriger des défaut sinon inconscients.
le cas typique est de changer de bordé les rameurs en pointe pour
les mettre en ligne.
Apprentissage d'habilités
Le transfert d'apprentissage:
être capable de ramer lentement et ensuite transférer
cela à la cadence de compétition.
on peut transférer des habilités telles que l'explosivité
des skat et les transférer au bateau (ou à défaut
à l'ergo) en alternant.
la phase de repos: moment privilégié pour fixer l'apprentissage:
dormir bien (on prépare mieux ses examens en dormant plus, pour
la technique de l'avironnement c'est pareil)
la méditation là encore est une
aide: si on médite le soir la vision pénétrante on
passe en revue sans modification des instants de la journée qui
resteraient sinon perdus dans l'inconscient. Je propose aussi l'exercice
suivant, au lieu de se concentrer sur sa respiration, tenter de se visualiser
en train de ramer (en y revivant et sans intervention de la pensée
verbale) et tenter de le faire continuellement sans distraction par d'autres
phénomènes mentaux.
Sur l'eau: ne pas hésiter à faire "les ponts" entre les
sensations présentes et celle vécues dans d'autres sports.
par
exemple sur l'attaque: rentrer sa pelle comme on rentre la pagaie en kayak...,
pousser sur ses jambes comme on envoie la purée sur une montée
en danseuse en vélo... tenir en équilibre sur de l'eau qui
bouge aussi bien que lorsqu'on cours sur la boue...
Courir sur la boue est un bon exercice d'équilibration qui profite
au bateau
!!! revenir toujours sur les bases essentielles de la technique
gamins en particulier: ne pas les saouler avec des explication abracadabrant,
explications courtes et essentielles
Il faut faire le feed-back: les commentaires sur la manière
de faire ce qu'on vient de demandé de faire doivent suivre.
Doit ont choisir entre
1 focalisation durant toute une séance sur un seul exercice?
(par exemple travailler le dégager)
2 mélanger aléatoirement les exercices?
la solution 2 est plus efficace à long terme
---intervention Dominique (thèmes de recherche à compléter)
facteurs de performance
Bonne technique, à la fois facteur de rendement et de compatibilité
des rameurs entre eux en bateaux long
processus énergétiques (20% anaérobie avec 80%
de base aérobie
Facteurs neuromusculaires: force coordination; faire faire 5 bond de
suite à des minimes pour évaluer l'importance du travail
à faire
facteurs biomécaniques: non modifiable, taille, longueur des
membres, et poids, modifiables: réglages de la barre de pieds, de
la hauteur de la barre de pieds, de l'angle d'attaque, de la longueur de
bras de levier, du rapport levier extérieur sur levier intérieur.
facteurs psychiques: tête de mule ou non, maniaque ou non, âme
de bourrin ou non, motivation.
diététique: pas aller manger chez maque-d'eau
optimisation des procédés d'entraînement
évolution des équipements
environnement
- social
-familial
-géographique
"système des facteurs de performance".
Technique
priorité chez les enfants
efficacité biomécanique
adaptabilité
stabilité
attention: on flingue souvent en deux saisons de jeunes rameurs en leur
mettant trop la pression.
les minimes ne doivent pas faire de la pointe (risque d'assymétrie)
Performances physiques
-force endurance aérobie
- capacité anaérobique lactique et alactique
- force de base (musculation travaillée à 60 progressif
vers 90% de charge type M1
- aptitude à la coordination
Tactique
-offensivité (envie de partir devant,
et manie de tirer plus dés qu'un bateau se met à vous rattraper)
- adaptabilité (aptitude à suivre le chef de nage, aptitude
à changer de méthode, etc.)
Facteur mentaux
- hiérarchie des motivations
- attitude (rigueur, respect des horaires, tête
de cochon ou pas)
- caractère
- volonté
- conscience
- confiance en soi
- autonomie
document sur la VO2. trouvé par moi même
sur internet
http://vo2max.chez.tiscali.fr/article.htm
1. Notion de VO 2 max et de seuil anaérobie.
La consommation maximale d'oxygène, ou VO2 max,
est une valeur fondamentale dans l'étude de la physiologie à
l'effort. Elle représente la quantité maximale d'oxygène
que l'organisme peut prélever dans l'air (par la respiration pulmonaire),
transporter ( par la circulation du sang ), et consommer ( par les muscles
) par unité de temps. Pour schématiser, plus cette valeur
sera élevé pour un individu plus il sera capable de maintenir
longtemps et à une vitesse élevé un effort ( endurance).
Elle est égale à environ 40 millilitres
par minute et par kilo chez l'homme et peut atteindre 70 à 90 ml/min/kg
chez l'athlète de haut niveau qui pratique un sport d'endurance
comme le marathon par exemple.
Le seuil anaérobie désigne le niveau
d'intensité de l'effort à partir duquel, si l'effort est
poursuivi et intensifié, on observe l'apparition d'acide lactique
dans le sang et l'augmentation de la production de gaz carbonique et donc
l'épuisement et l'arrêt de l'exercice : on dit que l'on est
dans le " rouge " au delà de la zone anaérobie. En endurance
le sportif devra s'efforcer de rester en deçà de cette zone.
2. Variation de la VO2 max.
Il faut savoir que la VO2 max est acquise pour une
bonne part dès la naissance, et n'est pas un champion de marathon
qui veut mais qui peut. La VO2 max ne peut s'améliorer que de l'ordre
de 20% pour un non sportif qui se met à un travail spécifique
de sa VO2max.
Nous sommes donc tous inégaux, mais tous capables
d'améliorer nos performances avec le travail, ce qui explique que
le marathon se court entre 2h 10 pour les meilleurs et 5h voir plus pour
les autres ; nous pouvons tous améliorer nos temps mais celui qui
court à 11 Km/h ne courra jamais à 19 Km/h.
En dehors de la génétique, d'autre facteurs
rentrent en jeu :
- L'âge : les valeurs les plus élevées
sont notées entre 18 et 25 ans, après 30 ans elles diminuent
régulièrement (0,8% par an) par diminution en outre de la
fréquence cardiaque maximale.
- Le sexe : en effet, la VO2 max est de 15 à
30 % plus élevée chez l'homme que chez la femme.
- L'entraînement : si celui-ci est bien conduit,
il peut l'augmenter considérablement. A l'inverse, un repos forcé,
pour une blessure par exemple, la diminue.
- La masse grasse : plus celle-ci est élevée,
moins la VO2 max le sera.
Dr BOMPARD Nicolas : médecin du sport.
dégénérescence de la race humaine: un
exemple chez les esquimaux trouvé dans la page
http://perso.wanadoo.fr/aemed/medsport.htm
________________________________________________
L'ENTREE DANS LA VIE
INACTIVE :
Les informations
précises recueillies à ce propos nous révèlent
que les activités physiques de nos ancêtres, à l'époque
du Paléolithique, suivaient un rythme hebdomadaire bien particulier
; les hommes chassaient d'un à quatre jours non consécutifs
par semaine, avec des journées de repos intercalées, alors
que les femmes s'adonnaient à la cueillette de végétaux
tous les 2-3 jours. Là ne s'arrêtaient pas leurs occupations
: il leur fallait aussi fabriquer des outils, surveiller les enfants, dont
le périmètre de jeu était très important et
dont estime que lors de leurs deux premières années ils étaient
portés sur pas moins de 1500 km. S'y ajoutait encore la découpe
du gibier, la préparation des vêtements, le transport de l'eau,
celui du bois pour le feu, et le déplacement des camps. Enfin les
danses, qui n'avaient rien de slows langoureux, constituaient la principale
activité récréative, plusieurs heures par nuit, plusieurs
nuits par semaine, ce qui fera certainement regretter à quelques-uns
de ne pas être nés à cette époque! Quoiqu'il
en soit, tout ceci représentait une sacrée dépense
calorique, qu'on sait relativement bien estimer. A titre d'illustration,
on considère que les Occidentaux ont actuellement une dépense
énergétique journalière totale qui équivaut
simplement au métabolisme de repos des hommes préhistoriques.
Cette nette réduction de la dépense explique sans doute l'augmentation
de l'adiposité et la perte de masse musculaire associées
à la sédentarité actuelle. Pour mieux caractériser
cette tendance à l'oisiveté générale, considérez
ce qui suit : pour qu'un Américain moyen arrive à approcher
la dépense énergétique totale des cueilleurs-chasseurs,
il devrait ajouter quotidiennement 17 calories par kg et par jour. Ceci
correspond à l'accomplissement de 17 km de course ou de 24 de marche
chaque jour.
Pour la première
fois dans toute l'Histoire de l'humanité, nous vivons dans une société
où ne sommes plus en mesure de nous confronter aux limites ultimes
de notre patrimoine génétique, on subit même une sorte
de "désadaptation" désastreuse, très voisine de celle
rencontrée par les champions au moment de leur retraite sportive.
A cet égard, le phénomène "Inuit" nous fournit de
précieuses informations. Un groupe de scientifiques a décidé
à la fin des années 60, de se livrer, tous les 10 ans pendant
30 ans, à une évaluation systématique des aptitudes
physiques d'un groupe à la fois important et représentatif
de cette ethnie (14). Trois séries de mesures furent ainsi obtenues,
en 1970, puis en 80 et en 90. Entretemps, la civilisation est arrivée
à eux, les soumettant à une sédentarisation et à
une occidentalisation radicales dont on a pu mesurer les conséquences
catastrophiques (voir le tableau). L'arrivée généralisée
des motoneiges, du mobilier de cuisine et du chauffage central s'est accompagnée,
en l'espace de deux décennies, d'une prise de masse grasse, d'une
diminution de la force et d'une chute de VO2 Max. La supériorité
qu'ils manifestaient par rapport aux Américains, en 1970, sur le
plan physique, est déjà bien moins évidente en 1990,
même si un petit écart subsiste encore. On peut penser que
le même phénomène ayant touché les populations
occidentales avec l'avènement du monde industriel, il est fort possible
que les recommandations actuelles, concernant le niveau d'activité
physique souhaitable, soit une sorte de consensus mou imposé par
l'indolence ambiante. CORDAIN n'hésite en tout cas pas à
écrire : "D'un point de vue évolutionniste, c'est le mode
de vie sédentaire des pays riches de l'époque contemporaine
qui constitue un extrème, pas celui qui a prévalu pour l'Homme
depuis nos origines jusqu'à l'ère industrielle." L'essor
de sports extrèmes comme le triathlon constituerait alors une sorte
de retour aux sources...
TABLEAU :
Evolution des aptitudes physiologiques des Inuits entre 1970 et 1990 (14)
.
Variables et âge
des sujets Hommes
| Puissance maximale
aérobie moyenne (ml.mn.kg) |
années69/70 |
79/80 |
89/90 |
| 20-29 ans |
58.4 |
53.2 |
51.1 |
| 30-39 ans |
55.5 |
47.6 |
46.0 |
| 40-49 ans |
51.6 |
45.1 |
41.5 |
| 50-59 ans |
41.6 |
38.6 |
35.2 |
| 60-69 ans |
37.9 |
34.7 |
33.9 |
On note que les
quadragénaires de 1970 possèdaient, en moyenne, une VO2 Max
supérieure à celle mesurée en 1990 chez les représentants
de la tranche d'âge 20-29 ans. Chez ces individus colonisés,
la diminution de la puissance maximale aérobie liée à
ce changement sociologique dépasse de loin la baisse inéluctable
imputable à l'âge. Le même constat peut être établi
à partir des chiffres relevés chez les femmes (non représentés
ici).
UNE AFFAIRE D'ADAPTATION
AU NEANT :
On a vu que, si
on se réfère aux recommandations de l'ACSM, il suffit d'effectuer
30 mn de marche à 5 km/h afin de rester en bonne santé. Cette
activité correspond, pour un individu "standart" de 70 kg, à
une dépense de 150 kcal, qui s'ajoutent aux 615 calories dont on
considère qu'elles représentent une bonne estimation du coût
de l'ensemble des actitivés ménagères et modérées
de la journée (4). Ce total représente alors une dépense
de l'ordre de 11 kcal/kg.j, ce qui reste bien en-deçà des
estimations proposées pour certaines ethnies comme les Ache (20
kcal/kg.j), et sans doute aussi de la dépense journalière
de nos ancêtres de l'Âge de Pierre, qui a fortement façonné
notre patrimoine héréditaire.
Les chiffres plus élevés
proposés par PAFFENBARGER, dans le cadre de ses travaux sur les
dockers,
font état d'une dépense de 9000 calories par semaine, chiffre
englobant l'activité professionnelle et le sport. Pour notre homme
de 70 kg, ces données représentent 137 kcal/kg par semaine
(25 km de course par jour), ce qui correspond exactement aux chiffres avancés
pour les ethnies de chasseurs-cueilleurs (4). Troublant, non?
Un point essentiel,
toutefois, distingue le mode d'exercice de nos ancêtres du nôtre
: Si on se réfère aux critères modernes d'entraînement,
il manque l'efficacité, dans le sens où on l'entend aujourd'hui.
L'essentiel du travail fourni par les hommes préhistoriques consistait
en effet en un très gros volume d'exercices effectués à
faible intensité, pour employer la terminologie en vigueur. Or,
on sait bien qu'on ne devient pas forcément mieux adapté
à l'effort en se contentant d'exercices à faible allure.
On peut donc donc considérer que le bénéfice retiré
du sport peut être comparable si on accroît l'intensité
des exercices et qu'on y consacre moins de temps
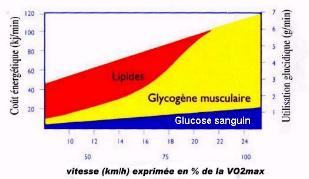

 image:
sur chaque palier on note la puissance lue en fonction de la FC
image:
sur chaque palier on note la puissance lue en fonction de la FC
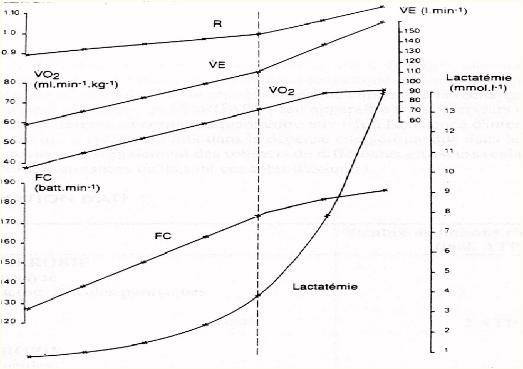
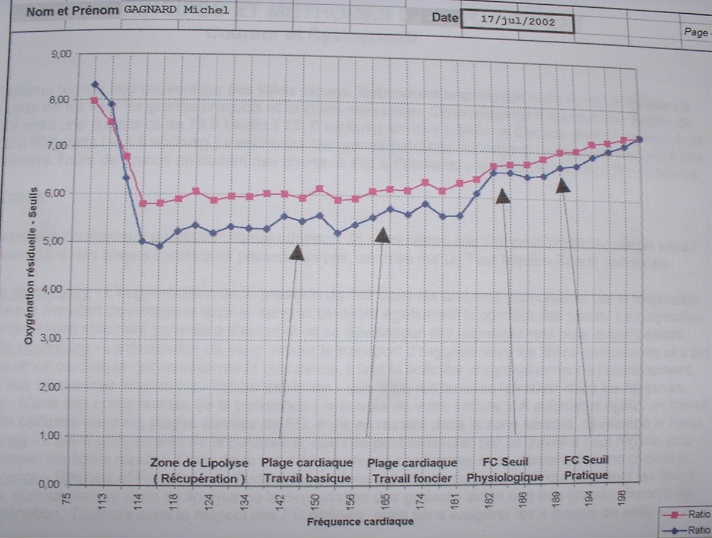 image:
en rouge le CO2 rejeté, en Bleu l'O2 consommé
image:
en rouge le CO2 rejeté, en Bleu l'O2 consommé
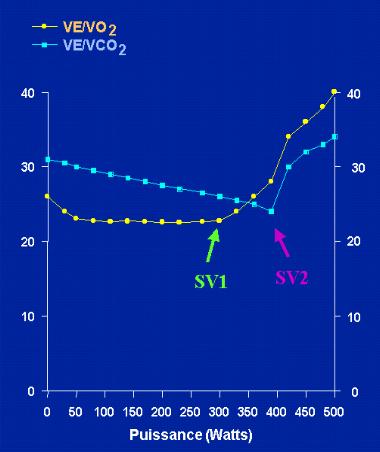 Comment
sont trouvés les seuils (il s'agit des seuils ventilatoires et non
des seuils lactiques)
Comment
sont trouvés les seuils (il s'agit des seuils ventilatoires et non
des seuils lactiques)